(Cet article est disponible sur mon site). Nous avons présenté dans la dernière chronique géopolitique
la Corée du Nord, cet état non-identifié, juridiquement en guerre avec
la Corée du Sud depuis 1950, et qui fait l’objet d’un certain nombre de
sanctions venant de l’ONU et des acteurs de la région du Pacifique pour
son développement en sous-main de l’arme nucléaire, et ses essais
balistiques. Depuis, les choses ont empiré, et les experts se creusent
la tête pour trouver une solution diplomatique, entre négociations et
sanctions.
« Fire and Fury » (D. Trump, 8 août 2017)
Le régime a réalisé un nombre
exceptionnel d’essais balistiques cette année. Le dix-huitième missile,
un ICBM pour « intercontinental ballistic missile », lancé le 29 août, a
parcouru près de 2700 kilomètres en passant, chose exceptionnelle, dans
l’espace aérien japonais, trois jours après l’essai la même journée de
trois missiles balistiques à courte portée tombés en mer du Japon. Quant
au programme nucléaire, il arrive semble-t-il à son terme, avec l’essai
« réussi » d’une bombe thermonucléaire le 3 septembre, le sixième du
régime.
Ces essais ont ravivé les tensions dans
une Asie déjà divisée. La Chine et la Russie sont les partenaires
privilégiés de la Corée du Nord, les Japonais et les Coréens du Sud
s’inquiètent de la pertinence des sanctions de l’ONU, d’autant plus que
la Corée du Sud est en première ligne, et les Américains possèdent à
moins de 3500 km de la péninsule coréenne la base de Guam, ainsi que la
VIIe Flotte de l’US Navy, faisant face à quelques difficultés, notamment après un accident mortel entraînant le retrait du vice admiral Joseph Aucoin.
« Paix impossible, guerre improbable » ? (R. Aron, 1948)
Mais davantage que ces manifestations
physiques et ces relations entre états, on note que c’est la lutte des
mots qui a pris le pas sur la lutte militaire. On connaissait déjà la
communication par l’invective du régime nord-coréen, proférant menaces
diverses à l’égard des autres régimes et glorifiant tout ce
qu’entreprend Kim Jong-Un et son état-major, mais le 45e président des Etats-Unis a fait fort en promettant à la Corée du Nord « fire and fury » le 8 août 2017 si elle franchissait la ligne rouge, entraînant évidemment une réponse, et un tollé diplomatique.
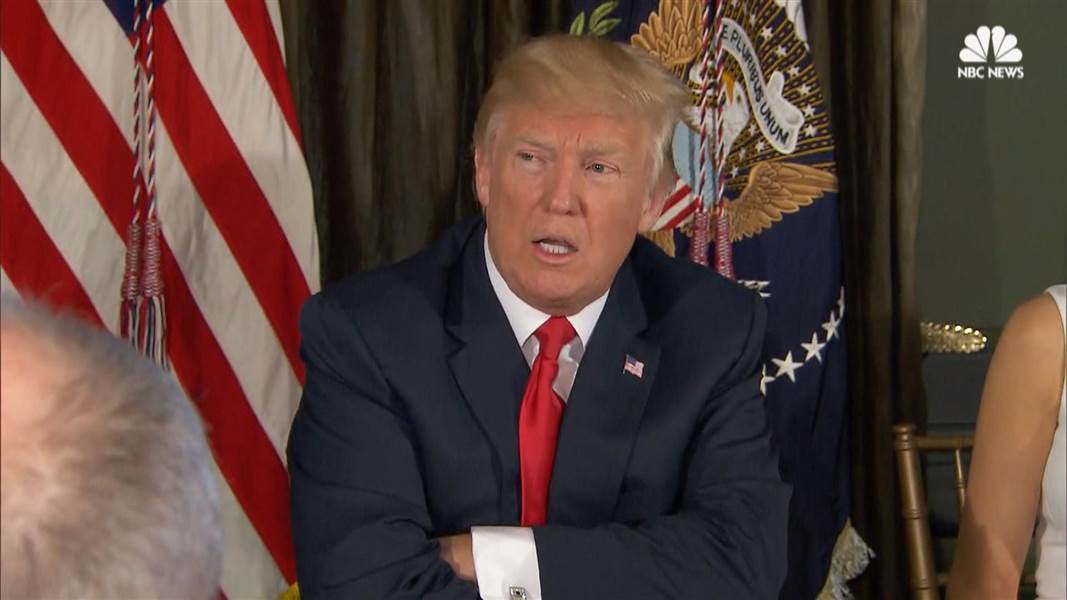
A ne pas confondre (malheureusement) avec la chanson du groupe Skillet ou la bande originale de Starcraft 2.
Malgré tout, la plupart des spécialistes
de la question nord-coréenne plaident pour la négociation. La Corée du
Nord s’est en effet construite autour de la menace américaine, et a
développé l’arme nucléaire pour être prête à réagir à une attaque
possible, tout en sachant que ses possibilités de provoquer le conflit
et de le gagner sont extrêmement limitées. Une guerre nucléaire ne
serait donc pas profitable au régime, ni d’ailleurs aux acteurs de la
région.
Qui veut la paix ?
Toutefois, les leviers de la négociation
restent peu efficients. Les sanctions commerciales et économiques
pèsent sur la Corée du Nord depuis plusieurs années, sans l’empêcher de
continuer son programme militaire et ses divers essais, aidée qu’elle
est en sous-main par ses alliés. Les nouvelles sanctions votées hier à
l’ONU ont d’ailleurs dû s’adapter aux demandes de la Chine et de la
Russie, membres permanents du Conseil de Sécurité, afin de limiter une
partie des sanctions, concernant notamment les importations de pétrole
et le rapatriement des expatriés nord-coréens.
Deux couples se dessinent. D’un côté,
les Américains et les Sud-Coréens, qui organisent chaque année des
exercices communs centrés sur les réponses à apporter en cas de conflit
avec la Corée du Nord ; de l’autre, la Chine et la Russie, alliées du
régime, et qui s’entendent assez bien pour promouvoir dans leur
communication leur volonté d’apaiser les tensions, loin des propos chocs
d’un Donald Trump, tout en organisant eux aussi chaque année des
exercices conjoints dans l’océan Pacifique, et même dans la mer Baltique
le 24 juillet 2017. Cette bataille de la communication reste
d’actualité, les acteurs se rejetant mutuellement la faute de
l’exacerbation des tensions.
Le bouclier anti-missiles sud-coréen
Les sanctions votées par l’ONU hier vont
donc se mettre en branle, tandis que la coopération militaire
américano-sud-coréenne se solidifie. En effet, le Terminal High Altitude Area Defense est un système de missiles antibalistiques développé par la firme américaine Lockheed Martin,
et dont les premiers éléments en Corée du Sud ont été déployés fin
avril 2017, après des négociations débutées deux mois plus tôt face aux
essais nord-coréens. Après l’essai nucléaire de septembre 2017, il a été
renforcé, ce qui a entraîné une manifestation sud-coréenne faisant 38
blessés.
Ce bouclier antimissile suit trois
éléments distincts : un puissant radar détectant le missile, un centre
de contrôle appelé TFCC pour THAAD Fire Controls/Communications,
et qui organise la riposte, et un lanceur de missiles en lien avec le
TFCC, la plupart du temps porté par un camion pour améliorer sa
mobilité, projetant si besoin est un missile antibalistique, qui ne
porte aucune charge explosive et vient percuter le missile adverse en
recourant uniquement à son énergie cinétique (Ec (en joules) = 1/2mv2).
Conclusion
Quoi qu’il en soit, la Chine ne veut pas
de l’influence américaine, matérialisée dans le THAAD, la VIIe Flotte
et les exercices conjoints avec la Corée du Sud, tandis que les
Américains les accusent d’aider la Corée du Nord, et voient d’un mauvais
œil le rapprochement avec la Russie, du Pacifique à la Baltique, mais
aussi les visées territoriales chinoises en mer de Chine.
La Corée du Nord profère des menaces, la Russie reste un peu en retrait
en promettant vouloir avec la Chine la paix, la Corée du Sud renforce
son bouclier anti-missiles et se félicite avec le Japon des nouvelles
sanctions prises contre la Corée du Nord. Tout reste à faire pour
apaiser les tensions dans ce point chaud de la planète.
Les autres Points d’Actu :
- Les attentats de Paris, crime de guerre de l’E.I (13/11/2015)
- François Hollande à la Sorbonne, la culture française à l’assaut de la culture de l’E.I. (6/11/2015)
- La France en guerre contre l’Etat Islamique ? (18/11/2015)
- Violence, crimes de masse et indécence (14/07/2016)
- Une paix par référendum ? (02/10/2016, Colombie)
- Donald Trump, la surprise de l’année ? (09/11/2016)
- Mossoul reprise, mais qui a gagné ? (09/07/2017)
- « Fire and Fury », la question nord-coréenne en suspens (12/09/2017)
































